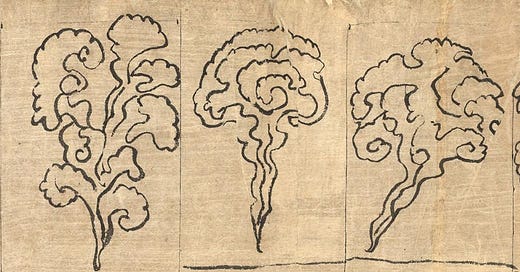La Chine vole-t-elle des nuages à l'Inde ?
Cette semaine, ne voyez-vous donc point les eaux du fleuve Jaune ? Elles descendent du ciel et coulent vers la mer sans jamais revenir.

Bonjour,
Nous sommes à J+68 de glue fasciste aux Etats-Unis, à 427 ppm de CO₂ dans l’atmosphère et aujourd’hui – haut les cœurs – on se demande si nous assisterons bientôt à une « guerre des nuages ».
Eh oui, cette perspective n’a rien de science-fictionnelle… Des pays investissent déjà dans leur capacité à contrôler les conditions météorologiques et, dans certaines zones tendues (Israël-Iran, Chine-Inde), des gouvernements s’accusent mutuellement de vol d’eau atmosphérique. Dans un monde déréglé, on voit bien comment se prémunir des sécheresses pourrait se faire au détriment de voisins.
Pour en discuter, j’ai pris un café avec Marine de Guglielmo Weber, qui est une amie puisque nous avons publié ensemble Le grand retournement (LLL). Marine a fait sa thèse sur la modification de la météo en France (parce que oui, cela existe). Elle est aujourd’hui chercheuse à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM). Elle revient d’un voyage en Inde où elle a rencontré des chercheurs et des politiques qui s’inquiètent des velléités chinoises de faire pleuvoir sur le plateau tibétain.
Dans la foulée de ce terrain d’études, elle a publié avec la chercheuse indienne Amrita Jash une note titrée Les pratiques chinoises d’ensemencement des nuages sur le plateau tibétain.
Aussi au programme, à la fin de cette newsletter : des nouvelles de la discrète start-up israélo-américaine qui s’est lancée dans la géo-ingénierie solaire ; le prochain rapport du Giec ; la bagarre autour du projet britannique ARIA.
Ma discussion avec Marine :
On est beaucoup à avoir entendu parler du projet chinois Sky River, qui vise à faire pleuvoir sur des lieux stratégiques. Mais on ne sait pas si cela existe vraiment et à quelle échelle…
Marine de Guglielmo Weber Oh, ça existe vraiment. Annoncé en 2015, ce programme de modification des conditions météorologiques doit être terminé cette année, en 2025. Concrètement, c’est un réseau de générateurs à iodure d’argent comme il en existe aussi en France. Des volutes de gaz chargées en particule s’élèvent de ces cheminées contrôlées à distance et viennent augmenter le nombre de noyaux de condensation dans les nuages. En théorie, cela permet de déclencher des précipitations. A ces milliers d’installations au sol s’ajoutent des outils de suivi et de modélisation, ainsi que des avions ou des drones. Le but est de détourner une partie de la mousson indienne pour irriguer le nord de la Chine.
Pourquoi ce projet est-il déployé sur le plateau tibétain ?
Ce plateau est le château d’eau de la région. La plupart des grands fleuves qui irriguent l’Inde et l’Asie – l’Indus, le Gange, le Brahmapoutre, l’Irrawaddy, la Salouen, le Mékong, le Yangtze et le fleuve Jaune – y prennent leur source. La moitié des habitants de cette planète en dépendent ! C’est aussi là que les Chinois ont identifié une convergence de rivières atmosphériques, de courants de vapeur d’eau, au-dessus de la région de Sanjiangyuan. Le but est de faire tomber la pluie à des endroits stratégiques afin que, par le système de canaux ou par les fleuves, l’eau remonte vers la plaine du nord.
On peut avoir l’impression que ce « détournement de nuages » est de la science-fiction, mais cet effort a des racines historiques profondes…
Oui, certains spécialistes en font même l’essence de ce pays : ce qui définit la Chine depuis des siècles, c’est l’ingénierie hydrique – canaux, barrages et aujourd’hui ensemencement des nuages. Dès 1956, sous Mao, est lancé un programme de recherche sur la modification de la météo. Le principe de répandre des noyaux glaçogènes dans les nuages pour faire pleuvoir vient d’être découvert aux Etats-Unis. Au début, le but est de lutter contre la sécheresse, contre la grêle également – puisque en faisant pleuvoir vous empêcher la formation de grêlons. Les grands barrages – comme le barrage des Trois Gorges – sont construits dans les années 1990 et 2000. A partir des années 2010, on observe une diversification des acteurs et des techniques. Les dirigeants parlent aussi de la sécurisation des ressources hydriques – en 2013, le premier ministre Wen Jiabao déclare par exemple que la pénurie d’eau menace « la survie de la nation ». En effet, le réchauffement climatique et la fonte des glaciers de l’Himalaya devrait assécher encore le pays. Sky River est officialisé deux ans plus tard.

Il y avait aussi eu le cas des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing...
Oui, la sécurisation de l’eau est la principale raison qui pousse la Chine à investir dans le contrôle de la météo, mais ce n’est pas la seule. Faire pleuvoir permet aussi de rincer la pollution atmosphérique. Le faire lors des grands évènements, comme les JO ou les défilés militaires, est une démonstration de puissance technologique. Le gouvernement chinois met aussi beaucoup en avant la restauration des écosystèmes. L’ensemencement des nuages est une technique hasardeuse, et il n’existe pas un consensus scientifique sur l’efficacité de ces méthodes. Mais on peut penser que si les Chinois investissent autant, c’est qu’ils ont des preuves solides que ça fonctionne sur leur territoire.
Quelles menaces ce contrôle de la météo fait-il peser sur ses voisins ?
Grâce au plateau tibétain – véritable centre de contrôle hydrique régional –, la Chine est déjà considérée comme une puissance hydro-hégémonique. Ce concept renvoie à la domination d’un Etat sur des ressources en eau transfrontalières. Paradoxalement, la Chine qui est menacée par la sécheresse est aussi très bien placée en amont des fleuves asiatiques. Si elle parvient, en plus, à transformer les rivières atmosphériques qui passent au-dessus de son territoire en précipitations, elle y gagne un pouvoir énorme.
Est-ce du « vol de nuages » ?
Ce peut être perçu comme tel par ses voisins. Dans le cas des fleuves, les Indiens sont déjà échaudés par le fait que la Chine ne communique pas toujours les données hydrologiques essentielles pour la prévention des inondations. La construction de barrage en amont peut aussi être vue comme un acte d’accaparement d’une ressource commune, qui réduit le débit en aval. Et voici qu’on parle d’ensemencement des nuages sur le plateau tibétain ! A plusieurs reprises, des dignitaires indiens ont laissé entendre que la Chine était en partie responsable d’inondations inattendues sur leur territoire. Il y a donc une crainte d’être à la merci de la Chine, qui pourrait même exercer un chantage météorologique…
L’Inde ne peut-elle pas invoquer la Convention Enmod, datant de 1976, qui interdit d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins hostiles ?
Pas vraiment. Cette convention a été pensée dans le sillage de la guerre du Vietnam, pendant laquelle l’armée américaine avait cherché à enliser l’ennemi en provoquant des pluies torrentielles. Mais dans le cas du conflit hydrique entre l’Inde et la Chine, comment prouver de la part de la Chine une intentionnalité néfaste ? Le gouvernement chinois pourra toujours dire qu’il n’a pas cherché à provoquer des dérèglements chez son voisin, qu’il avait une volonté purement domestique de restauration des écosystèmes ou de lutte contre la sécheresse. Il y a aussi un problème d’attribution : dans le contexte d’un réchauffement climatique qui dérègle les conditions météorologiques, comment prouver que telle ou telle sécheresse est liée aux cheminées à iodure d’argent ?

C’est un peu comme la cybersécurité : difficile d’attribuer l’attaque… Quels sont les leviers de l’Inde pour contenir cette menace ?
Eh bien, elle n’en a pas beaucoup. Les chercheurs que j’ai rencontrés se demandent s’ils ne pourraient pas s’armer météorologiquement, mais ils ne sont pas situés en amont des fleuves, ce qui limite leurs marges de manœuvre. L’Inde a un levier diplomatique ou militaire. Le problème, c’est que la Chine évacue toute gouvernance internationale de l’eau et ne signe que des traités bilatéraux parce que c’est beaucoup moins contraignant. Les Indiens conscients du danger sont très inquiets, se sentent très vulnérables.
Tu t'intéresses aussi à la géo-ingénierie solaire. Pourquoi étudier la modification de la météo sur le plateau tibétain te paraît une bonne manière de réfléchir à ce sujet ?
C’est une sorte de laboratoire d’études pour mieux comprendre les conflictualités que pourrait soulever la diffusion de soufre dans la stratosphère. Que se passerait-il si demain Donald Trump décidait de lancer un tel programme ? Nous serions tous comme l’Inde face à la Chine : complètement démunis. La convention Enmod ne permettrait pas de l’arrêter (à supposer qu’il se sente liés par les traités internationaux). Faire baisser les températures terrestres, même si cela provoque des bouleversements sur les moussons en Inde ou en Afrique, ne rentre pas dans la définition d’une intentionnalité militaire. De la même manière, nous serions confrontés aux mêmes problèmes d’attribution : comment lier telle sécheresse ou telle chute de la productivité agricole au voile solaire ? Ce qui se passe sur le plateau tibétain préfigure peut-être ce qui nous arrivera à tous ◆
✈️ Stardust, no comment ?
On revient sur Stardust. Il y a quelques numéros de cela, j’évoquais cette discrète entreprise israélo-américaine qui entend préparer la commercialisation du voile solaire et dit avoir « développé une particule non toxique (bio-safe) pour la réflexion de la lumière solaire, conçu un prototype de système de dispersion, et créé les outils de suivi et les capacités de modélisation nécessaires ».
Je leur avais alors envoyé une longue liste de questions (consultable ici). Après deux semaines et une relance, j’ai finalement reçu une réponse générale (reproduite sous les questions). Spoiler : c’est décevant. Ils reprennent grosso modo l’argumentaire de leur site. On y apprend tout juste que la « particule non toxique » n’est pas tirée du soufre. Pour justifier ce flou artistique, Stardust précise :
« Toutes les informations pertinentes seront rendues publiques bien avant qu'une quelconque mise en œuvre ne soit envisagée. Notre priorité est l'exactitude et la fiabilité, et non la rapidité. »
Le site Undark a publié un article avec les mêmes éléments ◇
🥋 Hajime !
Je vous parlais il y a deux semaines des débats dans la presse britannique autour du projet ARIA de recherche sur la géo-ingénierie solaire. Après la tribune très critique du climatologue Michael Mann et de son collègue Raymond Pierrehumbert, tous deux très connus, le Guardian a reçu des réponses de chercheurs piqués au vif. Par exemple, Matthew Henry, qui travaille sur la modélisation du voile solaire à l’université d’Exeter, estime que « les risques de la géo-ingénierie solaire doivent être mis en balance avec les risques liés au réchauffement » et que les « modèles climatiques contiennent de nombreuses incertitudes que des expériences en plein air à petite échelle et bien gérées peuvent réduire » ◇
💭 Ça se précise…
Le prochain rapport du Giec se prépare (dans la douleur) et, comme le précédent, il fera une place à la géo-ingénierie solaire. Dans le sixième rapport, le sujet était abordé de manière relativement succincte (avec un court paragraphe dans la synthèse, une cross-box de six pages et plusieurs passages dans le rapport du groupe I). Depuis, il y a eu beaucoup de recherches et pas mal de lobbying. Dans le plan en cours d’élaboration, le thème figure clairement dans les groupes I et II, et en filigrane dans le groupe III. L’une des grandes questions est de savoir si des IAMs, ces modèles socio-économiques utilisés pour façonner les scénarios politiques, intégreront cette gestion du rayonnement solaire… ◇
📆 A venir : modélisation du voile solaire. Cette newsletter a été éditée par Marie Telling.